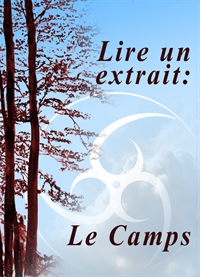Les Chroniques de Zadlande forment une trilogie d'anticipation autour d’un personnage secoué par un drame personnel, mais traitent plus largement de la condition et la manifestation de la véritable nature humaine à travers le prisme ou le prétexte d’une dystopie. Une façon, selon l’auteur, de dépouiller l’homme moderne de son habit de certitudes culturelles et de l’observer dans une parfaite nudité spirituelle voire originelle.

Dans ce roman, des survivants d'une station spatiale sont projetés sur une planète primitive nommée Planetae, semblable à la Terre d'il y a vingt millénaires. Pour survivre, ils doivent rapidement s'adapter. Leur rencontre avec les autochtones, loin d’être primitifs, bouleverse leurs idées sur l’évolution et le progrès. Cette aventure les pousse à une introspection profonde, redéfinissant leur rapport à la nature et à l’essentiel. Le récit invite à réfléchir sur la condition humaine, notre capacité d'adaptation et le sens de la vie.


Deux volumes de SHOT parus en 2025
En 1752 , un ancien lieutenant de la Maréchaussée est nommé commissaire à Ussel (Limousin)
En 1752 , un ancien lieutenant de la Maréchaussée est nommé commissaire à Ussel (Limousin)
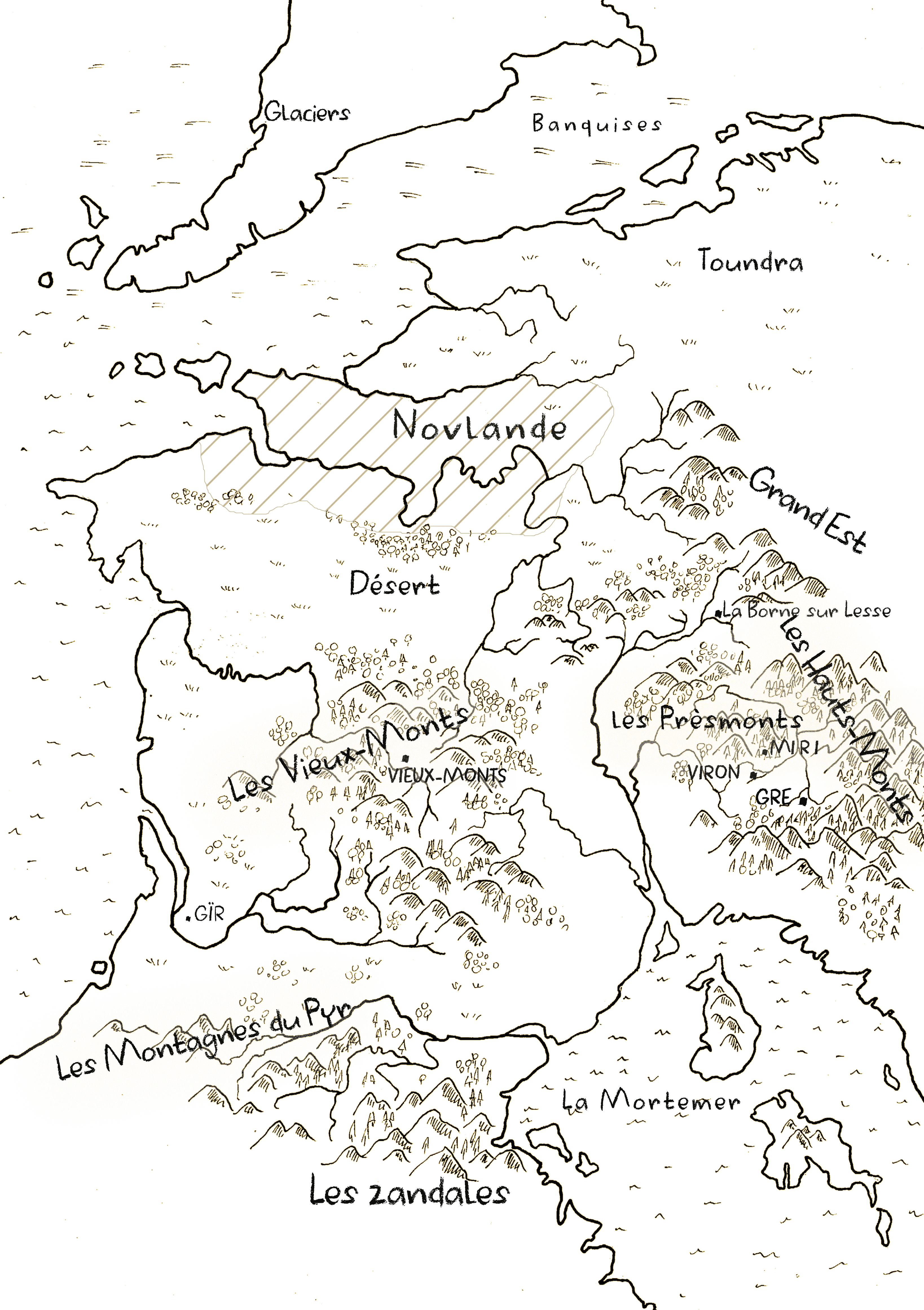
Les Chroniques de Zadlande : Les tributs (extrait)
Aurel se réveilla avec encore ce sentiment de bonheur qui lui était resté toute cette nuit. Il avait pour une fois dormi sans cauchemars ou rêves alambiqués. Il était serein et s’étira de tout son long avant que ne lui revienne à l’esprit le programme de la journée. Marie était déjà levée, probablement avait-elle dû quitter la chambre tôt le matin pour reprendre son service de domestique. À peine était-il assis sur le bord du lit prêt à s’habiller qu’on toqua à la porte.
— Monsieur Lerousic ! Votre petit-déjeuner, fit une voix derrière la porte.
— Entrez !
Marie-Madeleine apparut avec un plateau. Elle avait un air sombre et les yeux baissés. Aurel fut un instant inquiet. Mais dès que la porte fut refermée derrière elle, elle s’illumina en s’asseyant à ses côtés. Elle se libéra du plateau en lui posant sur les genoux et l’embrassa tendrement sur les lèvres. Aurel ne put rien faire, sinon éviter que le plateau ne bascule sous ce délicieux élan de tendresse de Marie. Ce baiser soudain le déconcerta, mais il l’apprécia sans aucune réserve.
— Bonjour Aurel, lui fit-elle rayonnante.
— Décidément en voilà une surprise, lui répondit-il. J’ai cru un moment que derrière la porte il y avait une autre personne. Je n’ai même pas reconnu ta voix.
— C’est que l’autre rôdait dans le couloir, je tenais à garder les apparences.
— Merci pour ce plateau. Et ce baiser… Mais il ne faut pas, enfin… je veux dire que…
— Chut ! fit-elle en lui mettant un doigt sur la bouche. Je sais ce que tu vas me dire. Que je ne dois pas tomber amoureuse de toi. Que ton cœur est déjà pris, en plus d’être brisé. Je sais tout ça, et je me contente de tout l’égard que tu peux avoir pour moi. Je sais que tu partiras dès la fin de l’hiver. Mais je ne peux pas me refuser, même si c’est pour un court moment de ma vie, ce dont j’ai été privée depuis toujours. J’avais envie de tes lèvres et pardonne-moi si je t’ai volé de baiser.
— Pardon accordé Madame ! fit-il en souriant. Ce fut une véritable torture, j’ai cru mourir ! plaisanta-t-il.
— Sinon, il ne faut pas que tu traînes trop, Jo t’attend pour la tournée. Les autres sont déjà partis.
— Tu as pu le prévenir de notre arrangement ?
— Bien sûr !
— Et il a pris ça comment ?
— Il était fou de rage et a promis de te faire la peau ! Non, je plaisante, il était heureux et même soulagé. Tu sais que tu fais peur à toute la garnison ! Qu’on dit de toi que tu es un être cruel et sans pitié.
— Allons bon ! En si peu de temps, une telle réputation !
— C’est probablement le Baron qui a dû en faire des louches à ton sujet. Toujours est-il que tu vas accompagner Jo dans un village pour faire le relevé des tributs.
— Tributs ?
— C’est une sorte de comptabilité que tient le Baron, les gens doivent déclarer ce qu’ils ont récolté ou fabriqué et c’est en fonction de cela qu’ils devront payer un tribut. Jo t’expliquera tout cela en chemin.
— Je comprends, un temps on appelait cela un impôt sur le revenu, mais aujourd’hui, c’est un tribut. Pour moi cela restera toujours une forme de racket, car en échange d’une protection quelconque, il y a toujours un tribut à payer. Dans le passé, on appelait cela des contributions ; en plus des taxes ou des charges sociales, il y avait aussi les assurances imposées par les lois, dont les prélèvements revenaient à des sociétés privées ! Bref, tout un répertoire de mots qui se résument bien aujourd’hui à celui de « tribut ». Et chacun contribue donc, bon gré mal gré, à maintenir des petits chefs au pouvoir en les nourrissant.
— N’empêche que le seigneur Lerousic profite en ce moment même des privilèges que ces tributs lui procurent.
— J’en suis conscient. Je me sens redevable. Je ne sais pas ni quand ni comment, mais cela sera rendu un jour ! Je ne peux vivre du racket, je ne suis pas un mafieux. Si ce système n’existait pas, les gens seraient autonomes, comme ils le sont déjà dans ma région, et organiseraient eux-mêmes leur protection et leur système de solidarité sans pour autant engraisser de sales parasites.
— Quand je n’étais encore qu’une étudiante en lettre, j’ai lu quelques auteurs du dix-huitième siècle qui traitaient déjà de tels sujets. Mais Aurel tu ne pourras pas changer le monde, surtout dans l’état où il se trouve aujourd’hui.
— C’est un fait ! Tu as raison. Mais je peux au moins essayer.
— Tu veux retrouver ta famille, n’est-ce pas là déjà une tâche importante ?
— Oui ! En attendant, j’apprends chaque jour que d’autres gens souffrent autant que moi. Et si je dois avoir un peu de temps, comme ici à patienter avant la fin de l’hiver, pour reprendre la recherche de ma famille, je peux au moins me rendre utile plutôt que de rester les bras ballants.
— Alors hâtes toi un peu. Jo doit se geler à t’attendre.
Aurel termina rapidement son repas matinal. Il eut encore droit à quelques témoignages d’affection de Marie, dont il ne lassait pas. Il s’habilla chaudement et rejoint Jo dans la cour du bâtiment.
Les Chroniques de Zadlande : Le camp (extrait)
Résumé : Aurel se trouve à l’intérieur d’un camp de réfugiés. Ambiance particulièrement délétère, c’est l’heure de la distribution de nourriture. Quelques réfugiés se font confisquer leur pitance par des crapules.
Pour certains, les provisions se faisaient dans l’estomac, ils se sentaient ainsi obligés d’avaler le tout prestement et sans faim, comme l’on ferait un plein de carburant. Aurel dévisagea le groupe de petits mafieux d’à peine une quinzaine d’individus. Il se dit que pour survivre ici, dans ce qui était une véritable prison, il faudrait en plus se soumettre à quelques sociopathes. Ce que beaucoup semblaient admettre comme une fatalité, l’excédait viscéralement. Il ne savait pas trop lesquels blâmer ; les militaires qui se repaissaient du dénuement de ces gens, les mécréants qui les abusaient en toute impunité, ou même cette foule de gens qui malgré leur nombre, ne bronchaient guère et se laissaient malmener.
La peur de manquer, la peur de mourir, la peur en elle-même avait cet étrange pouvoir de briser la force et la solidarité du groupe, de rendre les gens grégaires, prêts à tout accepter. Il suffisait de pas grand-chose pour soumettre une majorité. Selon toute logique physique, ce petit groupe ne pouvait en aucun cas soumettre la majorité. Mais ici, la potentielle force du nombre disparaissait pour ne se résumer qu’en une somme d’individualités soumises à leur propre peur. Les liens qui pouvaient unir ces gens, étaient brisés ou annihilés par leurs craintes individuelles. Aurel comprit alors le laisser-faire des gardes à l’égard des malfrats. Les quelques malandrins contribuaient à maintenir non pas un ordre, mais l’ordre des choses, telle une règle ancestrale. Ici on ne se méfiait ni des geôliers, ni des maîtres de ce camp, on craignait surtout l’acrimonie de quelques-uns parmi les détenus.
C’était là un ordre qui, par la peur, et ce depuis des siècles, avait toujours su aliéner une population. Toutes les formes de peur avaient jadis été de la sorte : Peur de l’enfer, peur de la guerre, peur de manquer, peur de la maladie, peur du chômage, peur de l’étranger, peur de son voisin. Nombre de vils esprits et gens de pouvoir parvenaient ainsi à se soustraire à la colère des peuples, derrière cette maîtrise, cette manipulation de la peur, se donnant de surcroît l’image rassurante du protecteur, du garant de l’ordre et de la sécurité. Et, comble de cette illusion, ces maîtres juraient avec l’aplomb d’un haruspice et la main sur le cœur, qu’ils œuvraient toujours au nom de l’intérêt général. Aurel n’était donc pas surpris de la docilité de ces gens à qui on avait tout confisqué pour la promesse d’une vie meilleure derrière cette muraille de fer.
Tous avaient dû subir ce camouflet de bienvenue et cette pseudo-décontamination. Comme lui, personne n’avait dû s’en plaindre comme l’indiquait l’absence de gardes armés lors de ces examens. Tous, et lui le premier, avaient accepté cette situation sans y être forcés. Chacun devait avoir ses propres raisons, ses objectifs ou s’accrochait à un grand espoir pour être capable d’endurer cette situation, somme toute assez affligeante. Aurel comprit qu’il était lui aussi assujetti à la peur, celle de faillir à sa mission, de perdre pour toujours ce qui avait été ses joies, son bonheur. Il n’était en rien différent de ces gens. Comment se préoccuper des autres quand on doit servir ses propres desseins ? Comment ne pas être quelque peu individualiste ? Il dut admettre que toutes ces personnes ne pouvaient être blâmées, car elles s’encourageaient chacune, comme lui, à un but, un intérêt individuel. Même si ici beaucoup n’agissaient pas aux dépens d’un autre, ils acceptaient de s’avilir aux dépens d’eux-mêmes, croyant à une étape incontournable et provisoire de leur vie. Aurel éprouvait lui aussi cette concession de liberté et la considérait aussi comme un sacrifice momentané. Il ne doutait pas que tous devaient avoir pris la mesure de cette abnégation particulière. Mais à qui cela profiterait ? En tireraient-ils tous un bénéfice ? Rien n’était aussi peu certain, si ce n’est que ce sacrifice revêtait les allures d’un pari. Un pari à haut risque qui aurait pour mise, l’abandon de libertés dans l’espoir de gagner et rehausser sa condition.
Si l’intérêt général était une conception ambiguë voire chimérique et le plus souvent usurpée, l’intérêt particulier n’en était pas moins obscur et conduisait à cet étrange et désolant spectacle d’assujettissement. En somme, pensa Aurel, l’espoir ou la convoitise d’une vie meilleure aboutissait malheureusement à ce que l’on s’accommode d’une vie de subordination. Une servitude ou forme d’esclavage dont on ne saurait reconnaître le véritable maître. Ce maître, serait-ce le désir même ou les créateurs de ce désir ? Ces pauvres gens s’engageaient, peut-être sans le savoir, dans une voie dont seuls quelques-uns tireraient leur épingle du jeu. C’était une gageure stupide, pensa celui qui avait toujours haï toute forme de pari. Ce jeu qui récompenserait quelques gagnants d’un statut social honorable, était selon lui une spéculation malsaine qui faussait l’accomplissement d’un individu. Une réussite sociale qui de fait, et quoi qu’il en coûte, prenait le pas sur la réalisation personnelle. Le bonheur ne pouvait se trouver dans la finalité d’un tel pari d’autant que la mise délestait les joueurs d’un pan complet de leur autonomie.